
La Déchéance du Terme du Prêt Bancaire
La déchéance du terme d’un prêt est un mécanisme juridique par lequel la totalité des sommes dues au titre du prêt devient immédiatement exigible par la banque.
Au cours de mes années de pratique en droit bancaire, j'ai constaté que la déchéance du terme demeure l'une des situations les plus redoutées par les emprunteurs, faute souvent de bien en comprendre les mécanismes et les implications juridiques.
C'est pourquoi j'ai jugé utile de vous proposer une analyse exhaustive de cette matière complexe.
I. Qu'est-ce que la déchéance du terme d'un prêt bancaire ?
La déchéance du terme est une clause contractuelle incluse dans tout contrat de prêt bancaire, qui confère au créancier le droit de demander le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû, augmenté des intérêts courus, avant l'expiration du délai initialement prévu.
II. Les causes qui mènent à la déchéance du terme
A. Le non-respect des échéances de remboursement
La cause la plus fréquente de déchéance du terme demeure incontestablement le défaut de paiement d'une ou plusieurs échéances contractuelles. Lorsqu'un emprunteur omet de verser la mensualité prévue au jour convenu, il commet un manquement à ses obligations.
B. La violation d'autres clauses contractuelles
Au-delà du simple non-paiement, d'autres violations contractuelles peuvent justifier la mise en œuvre de la déchéance du terme. Ces violations peuvent inclure :
- L'affectation du bien financé : Si vous avez emprunté pour acquérir un bien immobilier ou mobilier donné, tout changement d'affectation de ce bien ou sa vente pourrait constituer une violation contractuelle.
- L'absence de maintien des assurances requises : Les contrats de prêt exigent généralement que l'emprunteur conserve une assurance emprunteur. Le défaut d'assurance peut justifier la déchéance du terme.
- La défaillance du garant ou du cautionnaire : Si un tiers s'était porté garant ou cautionnaire, sa défaillance financière peut également constituer une cause de déchéance.
Ces clauses sont cependant soumises au contrôle de proportionnalité et d'absence de caractère abusif que j'aborderai ultérieurement.
III. La procédure de mise en œuvre de la déchéance du terme
A. L'importance de la mise en demeure préalable
Aucune déchéance du terme ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable adressée à l'emprunteur. Cette mise en demeure constitue un acte juridique essentiel dont la régularité conditionne entièrement la validité de la procédure.
La mise en demeure doit impérativement :
- Être adressée par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception
- Identifier clairement la créance en défaut (numéro de dossier, montant, date de l'échéance impayée) ;
- Informer précisément l'emprunteur des conséquences de son défaut de régularisation
- Exposer le montant total exigible, ventilé entre capital, intérêts et éventuels frais.
Je recommande vivement à tout emprunteur confronté à une telle mise en demeure d'en vérifier scrupuleusement la régularité formelle, car tout vice de procédure pourrait justifier l'annulation ultérieure de cette procédure.
B. Le délai raisonnable
Une question que me posent régulièrement mes clients concerne le délai entre la mise en demeure et l'invocation effective de la déchéance du terme. La loi impose un délai dit « raisonnable », concept qui a donné lieu à une jurisprudence abondante.
La jurisprudence considère généralement que un délai de deux mois entre la mise en demeure et la mise en œuvre effective de la déchéance du terme constitue un minimum convenable.
IV. Les conséquences de la déchéance du terme pour l'emprunteur
A. L'exigibilité immédiate de la totalité du prêt
La conséquence la plus directe et la plus lourde réside dans l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû. Si vous aviez emprunté 200.000 euros sur vingt ans et que vous n'aviez remboursé que les trois premières années, la banque pourrait exiger le remboursement des 160.000 euros restants dans un délai très court.
Cette situation crée une urgence financière majeure pour l'emprunteur et précipite souvent les difficultés économiques.
B. L'inscription au FICP (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers)
L'une des conséquences les moins visibles mais néanmoins très préjudiciables concerne l'inscription au FICP. Cette inscription intervient généralement après deux mois de retard de paiement et reste inscrite pour une durée de cinq ans.
L'inscription au FICP rend considérablement plus difficile, voire impossible, l'obtention de nouveaux crédits.
C. L'impact sur l'assurance emprunteur
L'assurance emprunteur, généralement obligatoire dans tout financement immobilier, peut être résiliée ou son montant considérablement augmenté. Certains contrats d'assurance prévoient explicitement que la déchéance du terme constitue un sinistre entraînant la cessation de la couverture.
D. Les risques de saisie ou de vente forcée
Au-delà de ces conséquences directes, la déchéance du terme ouvre la voie à des procédures contentieuses plus graves. La banque est fondée à intenter une procédure devant le Tribunal afin de faire reconnaître l'exigibilité immédiate du capital restant dû.
Après obtention dun jugement, la banque peut procéder à la saisie des actifs de l'emprunteur, et particulièrement à la saisie immobilière ayant fait l'objet du prêt hypothécaire. Cette vente forcée intervient généralement à un prix inférieur à la valeur réelle du bien et engendre des frais substantiels qui viennent s'ajouter à la dette initiale.
V. Comment éviter la déchéance du terme ?
A. Anticiper les difficultés de paiement
Le meilleur remède à la déchéance du terme demeure sa prévention. Il convient donc d'identifier au plus tôt tout risque de défaillance de paiement. Cette identification doit intervenir dès que vous percevez une diminution de vos revenus ou une augmentation de vos charges.
B. Contacter la banque pour trouver une solution amiable
Dès que des difficultés se dessinent, je recommande vivement de prendre contact avec votre banque. Contrairement à une idée largement répandue, les banquiers n'ont aucun intérêt à voir leurs emprunteurs faire défaut.
C'est pourquoi la grande majorité des banques sont disposées à négocier avec leurs clients des solutions amiables. Ces solutions peuvent inclure :
- La rééchelonnement du prêt : Augmentation de la durée du prêt et réduction conséquente des mensualités ;
- La suspension temporaire des paiements : Accord sur un délai de quelques mois au cours duquel vous ne verserez que les intérêts ;
Ces négociations doivent impérativement être menées par écrit et aboutir à un accord formalisé par avenant au contrat initial, afin que chacun connaisse précisément ses droits et obligations.
C. Suspendre le prêt en justice
Faute d'obtenir l'accord amiable de votre banque sur une suspension temporaire du prélèvement des échéances du prêt, Il est possible de saisir le Juge afin d'obtenir des délais de grace dans le cadre d'une action en suspension judiciaire du prêt.
VI. Que faire en cas de déchéance du terme prononcée ?
A. Vérifier la validité de la procédure
Si vous recevez une notification de déchéance du terme, la première démarche doit être de confier le dossier à un avocat spécialisé en droit bancaire afin de vérifier la régularité de la procédure suivie par votre banque.
Plusieurs aspects doivent être examinés :
- La validité de la mise en demeure : Contenait-elle tous les éléments requis par la loi ? A-t-elle été adressée par un moyen permettant d'établir la preuve de la réception ?
- Le respect du délai raisonnable : Votre banque a-t-elle respecté un délai suffisant entre la mise en demeure et la mise en œuvre de la déchéance ?
- Le caractère éventuellement abusif de la clause : La clause elle-même ne serait-elle pas contraire aux règles protégeant les consommateurs ?
Toute irrégularité peut justifier l'annulation en justice de la déchéance prononcée.
B. Déposer un dossier de surendettement
Si votre situation s'avère véritablement irrémédiable, si vos dettes deviennent manifestement disproportionnées à vos ressources, vous pouvez envisager de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement compétente dans votre département.
Cette procédure, régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code monétaire et financier, permet à un débiteur de personnes physiques en situation de surendettement d'obtenir un réaménagement de ses dettes, voire un effacement partiel ou total de celles-ci.
La demande s'effectue auprès de la Banque de France. Une fois le dossier de surendettement ouvert, les créanciers sont tenus de cesser toute procédure de recouvrement.
C. La vente à réméré comme alternative
Dans certains cas spécifiques, particulièrement en matière immobilière, la vente à réméré peut représenter une alternative à la saisie-vente forcée. Le réméré est une clause permettant au vendeur de récupérer le bien qu'il a vendu pendant un délai déterminé (généralement de deux ans), moyennant le remboursement du prix de vente augmenté d'une indemnité.
Cette opération permet à un propriétaire en difficulté financière de rester dans son logement et de conserver l'espoir de le récupérer ultérieurement.
VII. La déchéance du terme et le contrôle des clauses abusives
A. La notion de déséquilibre significatif
Une clause contractuelle est réputée abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, et cela contrairement aux exigences de bonne foi.
La jurisprudence a reconnu qu'une clause de déchéance du terme revêt un caractère proportionné lorsque :
- Elle ne peut être invoquée qu'en cas de défaillance substantielle de l'emprunteur ;
- Elle est précédée d'une mise en demeure régulière ;
- Un délai raisonnable est accordé à l'emprunteur pour régler ses échéances impayées;
- Les circonstances de l'espèce justifient réellement son invocation.
B. Le rôle du juge dans le contrôle des clauses
Les juges disposent d'un pouvoir général de contrôle des clauses contractuelles afin de vérifier leur caractère potentiellement abusif. Ce pouvoir de contrôle peut être exercé d'office ou à la demande de l'une des parties.
En matière bancaire, les juges ont ainsi annulé diverses clauses de déchéance du terme jugées disproportionnées au regard de la situation des emprunteurs et de la gravité de leurs manquements.
IX. Questions fréquentes sur la déchéance du terme
Q : La déchéance du terme peut-elle être automatique ?
R : Non. En droit français, la déchéance du terme ne s'enclenche jamais automatiquement. Elle doit être formellement mise en œuvre par la banque, suivant une procédure régulière incluant une mise en demeure préalable et le respect d'un délai raisonnable.
Q : La déchéance du terme résilie-t-elle l'assurance emprunteur ?
R : Elle ne la résilie pas de plein droit, mais elle peut en constituer un événement à l'origine de la résiliation.
Q : Puis-je contester la déchéance du terme après ma saisine du tribunal ?
R : Oui. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation complet lui permettant de maintenir ou d'annuler la déchéance du terme selon qu'elle lui paraît justifiée ou excessivement rigoureuse dans les circonstances de l'espèce.
Q : L'inscription au FICP est-elle définitive après une déchéance du terme ?
R : Non. L'inscription au FICP demeure valide pendant une durée de cinq ans à compter de la régularisation de la situation (remboursement des arriérés ou conclusion d'un nouvel accord).
Conclusion
La déchéance du terme d'un prêt bancaire demeure un mécanisme d'une extrême gravité pour les emprunteurs. Sa mise en œuvre revêt un caractère définitif susceptible de précipiter l'emprunteur dans une situation financière irrémédiable.
C'est pourquoi je recommande vivement à tous les emprunteurs de contacter rapidement en avocat en droit bancaire dès réception de cette lettre pour se faire conseiller.
Maître Guillaume PIERRE
Avocat en droit bancaire

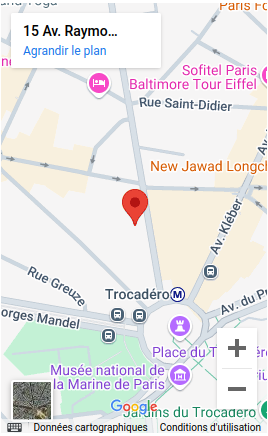
Nous nous permettons de vous solliciter en urgence afin d’examiner l’opportunité d’une saisine en référé du Juge des contentieux de la protection, en vue d’obtenir la suspension de la déchéance du terme prononcée par la banque LCL dans le cadre d’un prêt immobilier.
En effet, nous avons été informés par courrier que la banque avait procédé à la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, et qu’elle envisage désormais de diligenter une procédure de saisie ou de recouvrement judiciaire.
Nous traversons actuellement une période de difficultés financières, que nous estimons toutefois transitoire, certains éléments d’amélioration étant d’ores et déjà perceptibles.
Oui, je peux intervenir pour engager en urgence une saisine du juge afin de demander la suspension des effets de la déchéance du terme prononcée par le LCL.
Cette démarche est tout à fait opportune lorsque :
la situation financière du débiteur est temporairement dégradée,
il existe des perspectives concrètes de régularisation,
et que la procédure de recouvrement ou de saisie est imminente.
Le juge peut accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de grâce pouvant aller jusqu’à 24 mois, suspendant toute action d’exécution pendant ce temps.
Je vous confirme donc que nous allons engager cette procédure, à condition de réunir rapidement les pièces nécessaires :
le courrier de déchéance du terme,
le contrat de prêt et l’historique des paiements,
vos justificatifs de ressources actuels et à venir (bulletins, attestations, promesse d’embauche, etc.),
ainsi que tout élément prouvant que vos difficultés sont temporaires.
Bien cordialement
Bonjour Maître,
Je vous contacte concernant une procédure d’injonction de payer lancée par la Banque Populaire, suite à la déchéance du terme de notre prêt immobilier. Une audience est fixée devant le tribunal judiciaire de Paris. Je ne suis pas convoquée, mais il est indiqué que je dois être représentée par un avocat, à désigner sous 15 jours. Je souhaite conserver mon logement et étudie un rachat de crédit. J’aurais besoin de vos conseils et de votre représentation.
Merci !