
Le délai de forclusion : définition, régime et conséquences juridiques
En matière de procédures civiles, le délai de forclusion constitue une limite stricte imposée par le droit. Il encadre la possibilité d’agir en justice, notamment dans les litiges liés au crédit à la consommation, au surendettement, au cautionnement ou encore dans les procédures d’exécution.
Définition et différence avec la prescription
Le délai de forclusion est un délai légal, impératif et préfix. Contrairement à la prescription qui vise à éteindre une dette par l’écoulement du temps, la forclusion entraîne la perte définitive du droit d’agir une fois le délai expiré.
Ce délai est d’ordre public : il ne peut ni être suspendu ni interrompu. Le juge a l’obligation de le relever d’office si les conditions sont réunies.
Le point de départ du délai en matière de crédit
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, le délai de forclusion est de deux ans. Il débute généralement :
- À la date du premier incident de paiement non régularisé
- Ou à la date d’exigibilité de la dette, selon la nature du contrat
Par exemple, pour un découvert bancaire, le délai commence à courir dès que le solde devient exigible.
Forclusion et crédits renouvelables
Le régime juridique des crédits renouvelables prévoit que le point de départ du délai de forclusion intervient soit :
- Au premier incident de paiement non régularisé
- Au dépassement du montant autorisé non régularisé
Crédit et caution : quel délai de forclusion ?
Les créanciers disposent également d’un délai de deux ans pour agir contre une caution dans le cadre d’un crédit à la consommation. Le point de départ est la date à laquelle le cautionnement a été consenti.
Ce délai est fixé par l’article L311-37 du Code de la consommation, applicable aux créanciers comme aux débiteurs.
Peut-on interrompre ou suspendre le délai de forclusion ?
Non. Le délai de forclusion est un délai préfix. Il ne peut être interrompu par une action ou suspendu par un événement extérieur. Une fois expiré, il produit un effet radical : la perte du droit d’agir en justice.
Quelles conséquences en cas d’expiration ?
L’expiration du délai constitue une fin de non-recevoir. L’action est déclarée irrecevable, même si la créance est fondée.
Le juge civil est tenu de constater cette irrecevabilité, sans que le débiteur n’ait besoin de la soulever. Cela s’applique notamment aux actions introduites par les banques ou les entreprises de recouvrement.
Existe-t-il des exceptions ou une mainlevée ?
Une demande de relevé de forclusion peut être introduite dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’empêchement absolu d’agir. Mais ces situations sont encadrées strictement par la jurisprudence civile (ex. Cass. civ. 1re, 12 nov. 2020).
Délai de forclusion dans d’autres domaines
Ce mécanisme s’applique aussi à d’autres procédures :
- Recours en propriété immobilière (art. 2271 civ)
- Litiges en matière de transport
- Responsabilité du constructeur (ouvrage)
- Révision des clauses contractuelles
Dans ces cas, la durée et le point de départ varient selon la loi ou le contrat (obs. Dalloz, fenêtré dans les plans de surendettement).
Conclusion
Le délai de forclusion est un outil juridique puissant, mais contraignant. Il oblige les créanciers à agir dans un délai court et rigide. Le non-respect de ce délai entraîne la perte irrémédiable des droits d’action, sauf cas très particuliers.
Il est donc essentiel de connaître le régime applicable selon la nature du contrat, la date d’incident ou d’exigibilité, et d’anticiper les actions à mener pour préserver ses intérêts.

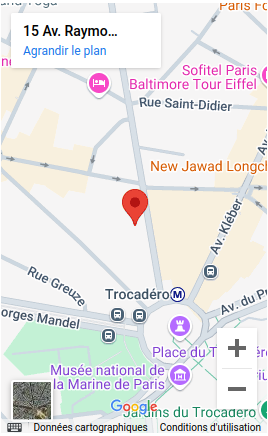
Un crédit à la consommation a été fait en 2014. Il y a eu une ordonnance d’injonction de payer en 2014 revêtue de la forme exécutoire le 29 janvier 2015.
Je reçois en avril 2025 un commandement aux fins de saisie vente. J’aimerais savoir s’il y a prescription.
Je ne me souviens pas si pendant ces 10 ans j’ai eu une relance.
Merci