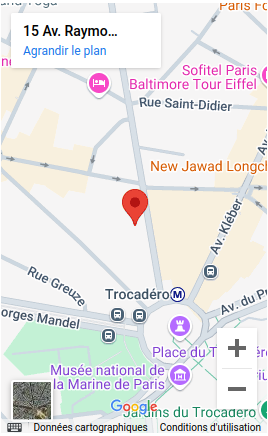Désolidarisation d’un Prêt Immobilier
La désolidarisation d'un prêt immobilier est une question que je rencontre régulièrement dans ma pratique d'avocat en droit bancaire. Souvent, cette problématique survient lors de moments difficiles : une séparation, un divorce, ou simplement lorsque les circonstances de vie changent et qu'un co-emprunteur souhaite se libérer de son engagement.
Nombreux de mes clients découvrent avec surprise que sortir d'un crédit immobilier n'est pas aussi simple qu'y entrer. La solidarité bancaire, acceptée sans trop y réfléchir au moment de l'achat, devient alors un véritable casse-tête juridique et financier.
Je vous explique concrètement ce qu'est la désolidarisation d'un prêt immobilier, dans quelles situations elle est possible, quelle procédure suivre, et surtout, comment maximiser vos chances d'obtenir l'accord de votre banque.
Qu'est-ce que la Désolidarisation d'un Prêt Immobilier ?
La solidarité bancaire
Lorsque vous contractez un prêt immobilier à plusieurs, vous signez généralement une clause de solidarité. Concrètement, cela signifie que chaque co-emprunteur est responsable de la totalité de la dette, et non pas seulement de sa quote-part.
La banque peut donc réclamer le remboursement intégral du prêt aux deux emprunteurs, indépendamment de ce qui a été convenu entre eux. C'est une sécurité considérable pour la banque, et c'est précisément pour cette raison qu'elle y renonce rarement facilement.
Qu'est-ce que la désolidarisation concrètement ?
La désolidarisation consiste à obtenir la libération juridique de l'un des emprunteurs de son obligation de remboursement. Une fois la désolidarisation actée, cette personne n'est plus tenue de rembourser le crédit et ne peut plus être poursuivie par la banque en cas de défaillance du co-emprunteur restant.
Pourquoi cette désolidarisation est compliquée ?
Du point de vue de la banque, accepter une désolidarisation revient à perdre une garantie importante. Elle passe d'une situation où elle peut se retourner contre deux personnes à une situation où elle n'a plus qu'un seul débiteur. Le risque de défaut de paiement augmente mécaniquement.
Quand peut-on demander une désolidarisation d'un prêt immobilier ?
Séparation ou divorce : le cas le plus fréquent
La majorité des demandes de désolidarisation que je traite concernent des couples qui se séparent. Qu'il s'agisse d'un divorce, d'une rupture de PACS ou d'une séparation de concubins, la situation est similaire : l'un des deux souhaite quitter le domicile commun et ne plus être lié financièrement au crédit immobilier.
Dans le cadre d'un divorce, le juge aux affaires familiales peut décider de l'attribution du bien immobilier à l'un des époux. Toutefois, cette décision judiciaire ne lie pas la banque. Même si le juge attribue le bien et le prêt à votre ex-conjoint, vous restez juridiquement solidaire tant que la banque n'a pas accepté la désolidarisation.
Rachat de soulte avec ou sans désolidarisation
Souvent, la désolidarisation d'un prêt immobilier s'accompagne d'un rachat de soulte : l'un des co-emprunteurs rachète la part de l'autre.
Il est tout à fait possible de racheter la part de son ex-conjoint sans obtenir sa désolidarisation du prêt. Dans ce cas, il devient propriétaire unique mais vous restez tous deux engagés solidairement vis-à-vis de la banque. Une situation juridiquement bancale que je déconseille fortement.
Autres situations possibles
Plus rarement, une désolidarisation peut être demandée dans d'autres contextes :
- Un accord amiable entre co-emprunteurs qui ne sont pas en couple (investissement locatif entre amis ou membres d'une même famille)
- Le décès d'un co-emprunteur, bien que dans ce cas l'assurance décès prenne généralement le relais
- Un changement de situation professionnelle majeur de l'un des emprunteurs
- En préalable à la vente du bien, pour clarifier la situation juridique
La procédure de désolidarisation d'un prêt immobilier
Étape 1 : L'accord de toutes les parties
Avant toute démarche, il faut obtenir trois accords :
- L'accord du co-emprunteur qui souhaite se désolidariser
- L'accord du co-emprunteur qui reste (qui va supporter seul la charge du crédit)
- L'accord de la banque (c'est le plus difficile à obtenir)
Sans l'un de ces trois accords, la procédure ne peut pas aboutir. Dans ma pratique, je constate que c'est souvent l'accord de la banque qui pose problème, mais parfois c'est aussi le refus de l'un des co-emprunteurs qui bloque la situation.
Étape 2 : L'étude de solvabilité du co-emprunteur restant
C'est l'étape cruciale. La banque va analyser en détail la capacité financière du co-emprunteur qui reste pour vérifier qu'il peut assumer seul le remboursement du prêt.
Les critères examinés par la banque :
- Le taux d'endettement : il ne doit généralement pas dépasser 35% des revenus nets (charges de crédit / revenus). Si le co-emprunteur restant dépasse ce seuil en supportant seul la mensualité, la banque refusera probablement.
- La stabilité des revenus : CDI, fonctionnaire, profession libérale établie... La banque privilégie les situations professionnelles stables.
- Le reste à vivre : après paiement de toutes les charges, il doit rester suffisamment pour vivre décemment.
- L'historique bancaire : absence d'incidents de paiement, bonne gestion du compte.
Les documents généralement à fournir :
- Bulletins de salaire des 3 derniers mois
- Avis d'imposition
- Justificatifs de charges (autres crédits, pensions alimentaires...)
- Relevés de compte bancaire
- Justificatif de domicile
Étape 3 : Le rachat de soulte
Si le bien immobilier appartenait en indivision aux deux co-emprunteurs, celui qui reste doit généralement racheter la part de celui qui part. Cette opération s'appelle le rachat de soulte.
Comment calculer la soulte à verser ?
La formule de base est simple : Soulte = (Valeur du bien - Capital restant dû) × Pourcentage de détention de celui qui part
Exemple concret :
- Valeur actuelle du bien : 300 000 €
- Capital restant dû : 200 000 €
- Quote-part de votre ex-conjoint : 50%
- Calcul : (300 000 - 200 000) × 50% = 50 000 €
L'ex-conjoint qui part recevra donc 50 000 € en contrepartie de l'abandon de ses droits sur le bien.
Le financement de la soulte :
Pour financer cette soulte, vous disposez de plusieurs options :
- Utiliser votre épargne personnelle
- Contracter un nouveau prêt spécifique (prêt de rachat de soulte)
- Négocier avec votre banque pour augmenter le capital du prêt existant
Étape 4 : L'intervention du notaire
La désolidarisation d'un prêt immobilier nécessite obligatoirement l'intervention d'un notaire, car elle s'accompagne généralement d'une modification de la propriété du bien.
Le rôle du notaire sera de :
- Rédiger l'acte de cession de parts (ou de rachat de soulte)
- Publier cet acte au service de publicité foncière
- Vérifier que toutes les conditions sont remplies
- S'assurer du paiement de la soulte
- discuter avec la banque
Étape 5 : La signature de l'avenant au contrat de prêt
Une fois l'accord de la banque obtenu et l'acte notarié signé, la banque établit un avenant au contrat de prêt initial. Cet avenant actait formellement la désolidarisation et ne mentionne plus que le co-emprunteur restant.
Attention : certaines banques en profitent pour renégocier les conditions du prêt (taux, durée, garanties). Soyez vigilant et n'hésitez pas à vous faire conseiller par un avocat en droit bancaire.
Étape 6 : L'adaptation de l'assurance de l'unique emprunteur
Point souvent négligé mais essentiel : l'assurance emprunteur doit être adaptée à la nouvelle situation. Si l'assurance couvrait 50% pour chaque emprunteur, il faudra désormais une couverture à 100% pour l'emprunteur restant.
Cela peut entraîner une augmentation du coût de l'assurance, mais c'est obligatoire. La banque exigera cette couverture complète avant d'accepter la désolidarisation.
Quelles sont les difficultés possibles ?
Le refus de la banque : pourquoi ?
Dans ma pratique, je constate que les banques refusent environ 40 à 50% des demandes de désolidarisation. Les raisons sont multiples.
Les motifs de refus les plus fréquents :
- Capacité de remboursement insuffisante : c'est de loin la raison principale. Si le taux d'endettement du co-emprunteur restant dépasse les 35%, la banque refusera quasi systématiquement.
- Instabilité professionnelle : vous êtes en CDD, en période d'essai.
- Historique bancaire problématique : découverts répétés, incidents de paiement...
- Montant du capital restant dû trop élevé : en début de prêt, quand il reste 20 ou 25 ans de remboursement, les banques sont plus réticentes.
Que faire en cas de refus ?
- Négocier avec la banque : proposer des garanties supplémentaires (caution d'un tiers, hypothèque complémentaire...)
- Améliorer votre dossier : augmenter ses revenus (promotion, changement d'emploi...), réduire ses autres charges, attendre une situation plus stable.
- Changer de banque : faire une demande de rachat de crédit auprès d'une autre banque qui accepterait la désolidarisation. Attention, cela représente des frais importants.
- Envisager la vente du bien : si aucune solution n'est possible, la vente reste l'option la plus sûre pour se libérer tous les deux.
- Saisir le juge : dans le cadre d'un divorce, le juge peut ordonner à l'un des époux de tout mettre en œuvre pour obtenir la désolidarisation, voire ordonner la vente si aucune solution n'aboutit.
Le refus d'un des co-emprunteurs
Parfois, ce n'est pas la banque qui refuse, mais l'un des co-emprunteurs lui-même. Les motivations peuvent être diverses : volonté de nuire, désaccord sur le montant de la soulte, refus de perdre ses droits sur le bien...
Les recours possibles :
En cas de désaccord persistant, il faut saisir le tribunal. Dans le cadre d'un divorce, c'est le juge aux affaires familiales qui tranchera. Il pourra :
- Ordonner le rachat de soulte par l'un des époux
- Ordonner la vente du bien en cas d'impossibilité de rachat
- Fixer le montant de la soulte en cas de désaccord sur l'évaluation
En dehors du divorce (concubinage, PACS, investissement entre amis), il faudra saisir le tribunal judiciaire et engager une procédure de partage judiciaire ou de licitation (vente forcée).
Les coûts à prévoir
La désolidarisation d'un prêt immobilier représente un coût non négligeable. Il faut anticiper :
Le notaire :
- Pour un rachat de soulte : environ 2 à 3% de la valeur du bien (frais d'enregistrement, émoluments du notaire, taxe de publicité foncière)
- Pour un bien de 200 000 € : comptez entre 4 000 et 6 000 €
Les frais bancaires :
- Frais de dossier pour l'avenant : entre 0 et 500 € selon les banques
- Frais de mainlevée d'hypothèque si changement de garantie : entre 0,3 et 0,5% du capital initial
- Si rachat de crédit externe : frais d'indemnités de remboursement anticipé (IRA), généralement 3% du capital restant dû (plafonnés à 6 mois d'intérêts)
Les frais d'assurance :
- Augmentation de la prime d'assurance emprunteur pour couvrir 100% au lieu de 50%
- Éventuels frais d'adhésion à un nouveau contrat
Modèle de lettre de demande de désolidarisation d'un prêt immobilier
Voici un modèle de lettre que vous pouvez adresser à votre banque qu'il faudra personnaliser selon votre situation.
[Vos Nom et Prénom]
[Votre adresse]
[Nom de la Banque]
[Adresse de l'agence]
À [Ville], le [Date]
Objet : Demande de désolidarisation du prêt immobilier n° [numéro de contrat]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Madame, Monsieur,
Je suis titulaire, conjointement avec [Nom et Prénom du co-emprunteur], d'un prêt immobilier souscrit auprès de votre établissement le [date de souscription], d'un montant initial de [montant] €, destiné à financer l'acquisition du bien situé [adresse du bien].
En raison de [notre séparation / notre divorce / préciser la situation], nous souhaitons procéder à une désolidarisation de ce prêt immobilier. [Nom du co-emprunteur qui reste] conservera le bien immobilier et assurera seul(e) le remboursement des mensualités restantes.
Je me permets donc de solliciter votre accord pour cette désolidarisation et vous prie de bien vouloir étudier la capacité de remboursement de [Nom du co-emprunteur qui reste].
Vous trouverez ci-joint les documents justificatifs suivants :
- Bulletins de salaire des trois derniers mois de [co-emprunteur restant]
- Dernier avis d'imposition
- Justificatifs de charges actuelles
- [Tout autre document utile]
[Si applicable : Un rachat de soulte sera réalisé par acte notarié, Maître [Nom du notaire] est en charge du dossier.]
Je reste à votre entière disposition pour vous fournir tout complément d'information et vous rencontrer afin d'étudier ensemble les modalités de cette désolidarisation.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
[Signature]
[Nom et Prénom]
Conseil : envoyez cette lettre en recommandé avec accusé de réception pour avoir une preuve de votre démarche.
Les Alternatives à la désolidarisation d'un prêt immobilier
Si malgré tous vos efforts la désolidarisation s'avère impossible, il existe d'autres solutions :
La vente du bien immobilier
C'est souvent la solution la plus simple et la plus propre. En vendant le bien, vous remboursez le crédit par anticipation et vous vous libérez tous les deux définitivement.
Les avantages :
- Libération totale et immédiate des deux co-emprunteurs
- Pas besoin de l'accord de la banque pour se désolidariser
- Partage du bénéfice (ou de la perte) entre les deux parties
Les inconvénients :
- Perte du bien immobilier pour les deux
- Frais d'agence immobilière (3 à 8% du prix de vente)
- IRA (indemnités de remboursement anticipé) : généralement 3% du capital restant dû
- Délai de vente parfois long compte tenu des taux d'intérêts actuels
Le rachat de crédit par une autre banque
Si votre banque actuelle refuse la désolidarisation mais qu'une autre banque accepte de financer le co-emprunteur restant seul, vous pouvez procéder à un rachat de crédit.
Comment ça fonctionne :
- Vous faites racheter votre prêt par une nouvelle banque
- Cette nouvelle banque accorde le prêt au nom du seul co-emprunteur restant
- L'ancien prêt est soldé, vous êtes automatiquement désolidarisé
Les inconvénients :
- Coût élevé : frais de dossier, IRA, frais de garantie, frais de notaire...
- Perte des conditions de taux avantageuses si vous aviez un taux bas
- Nouvelle étude complète du dossier
Attention : juridiquement, tant que la désolidarisation n'est pas actée, vous restez responsable. Si votre ex-conjoint ne paie plus, la banque peut se retourner contre vous. Cette solution n'est que temporaire.
Questions fréquentes posées par mes clients :
Qui paie la soulte en cas de désolidarisation ?
C'est celui qui conserve le bien qui paie la soulte à celui qui renonce à ses droits sur le bien. Le montant correspond à la valeur de la part détenue dans le bien, déduction faite du capital restant dû.
Peut-on refuser une désolidarisation de prêt ?
Oui, chacune des trois parties (les deux co-emprunteurs et la banque) peut refuser. La banque refuse généralement si la capacité de remboursement est insuffisante. Un co-emprunteur peut refuser s'il n'est pas d'accord avec les conditions proposées. En cas de blocage, seul le juge peut trancher.
Combien de temps prend une procédure de désolidarisation ?
En moyenne, comptez entre 3 et 6 mois, parfois plus si le dossier est complexe. Les délais dépendent de :
- La réactivité de la banque
- L'intervention du notaire
- Les éventuelles négociations ou blocages
La désolidarisation est-elle automatique en cas de divorce ?
Non, absolument pas. C'est une idée reçue très répandue. Le jugement de divorce ne lie pas la banque. Même si le juge attribue le bien et le prêt à votre ex-conjoint, vous restez solidaire du crédit tant que la banque n'a pas formellement accepté votre désolidarisation.
Puis-je me désolidariser sans vendre ma part du bien ?
Techniquement oui, mais c'est très rare et fortement déconseillé. Vous resteriez copropriétaire du bien sans être responsable du crédit. En pratique, la banque refuse presque toujours cette configuration car elle perd une garantie sans contrepartie. De votre côté, vous restez propriétaire d'un bien dont vous ne contrôlez pas la gestion.
Quels sont les risques si je ne me désolidarise pas ?
Si vous ne vous désolidarisez pas et que votre ex-conjoint cesse de payer les mensualités, la banque peut :
- Se retourner contre vous pour exiger le remboursement total
- Saisir vos biens et vos revenus
- Inscrire un fichage FICP (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers)
- Poursuivre la vente forcée du bien
Vous devrez alors payer à la place de votre ex-conjoint et engager une procédure pour vous retourner contre lui, ce qui est long et coûteux.
La désolidarisation de prêt impacte-t-elle ma capacité d'emprunt future ?
Si vous êtes celui qui se désolidarise : oui, positivement ! Vous n'aurez plus cette charge dans votre taux d'endettement, ce qui améliore votre capacité à emprunter à nouveau.
Si vous êtes celui qui reste : l'impact dépend de votre taux d'endettement après désolidarisation. Si vous êtes proche des 35%, votre capacité d'emprunt pour un nouveau projet sera limitée.
Conclusion : Les bons conseils de Maître PIERRE
La désolidarisation d'un prêt immobilier est une opération complexe qui nécessite l'accord de trois parties aux intérêts parfois divergents. Après avoir accompagné des dizaines de clients dans cette démarche, voici mes recommandations essentielles :
1. Anticipez : Plus vous vous y prenez tôt, plus vous aurez de marge de manœuvre. N'attendez pas que la situation devienne conflictuelle pour engager les démarches.
2. Préparez un dossier : Votre banque sera d'autant plus encline à accepter que le dossier du co-emprunteur restant est irréprochable.
3. Négociez : Si la banque émet des réserves, proposez des solutions : augmentation de la durée du prêt pour réduire les mensualités, apport de garanties supplémentaires, caution d'un tiers...
4. Faites-vous accompagner : La désolidarisation implique des aspects juridiques, bancaires et fiscaux complexes. L'accompagnement par un avocat spécialisé en droit bancaire est souvent déterminant pour le succès de l'opération.
5. Conservez tout : Conservez les preuves de toutes vos démarches, de tous les accords, même informels. En cas de conflit ultérieur, ces éléments seront précieux.
6. Pensez au long terme : Une désolidarisation mal négociée peut avoir des conséquences pendant des années. Prenez le temps de bien mesurer tous les impacts financiers et juridiques.
7. Envisagez toutes les options : La désolidarisation n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, la vente du bien est plus simple, moins coûteuse et plus sécurisante pour les deux parties.
Dans mon cabinet, j'accompagne régulièrement des clients dans leurs démarches de désolidarisation. Mon rôle est de :
- Analyser votre situation et vous conseiller sur la stratégie à adopter
- Préparer votre dossier pour maximiser vos chances d'acceptation
- Négocier avec la banque en votre nom
- Coordonner avec le notaire
- Sécuriser juridiquement l'opération
- Vous représenter devant le juge si nécessaire
Si vous êtes confronté à une situation de désolidarisation de prêt immobilier, n'hésitez pas à me contacter pour un premier échange. Chaque situation est unique et mérite une analyse personnalisée.
Maître Guillaume PIERRE
Avocat en droit bancaire