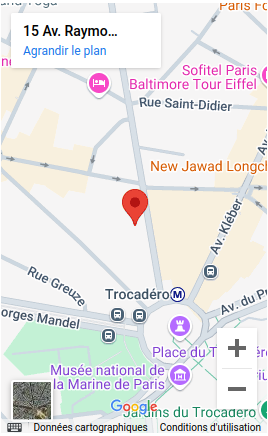Le délai de prescription de deux ans en matière bancaire
Le délai de prescription de deux ans reste une notion mal comprise par de nombreux particuliers. Pourtant, cette règle peut avoir des conséquences déterminantes sur le recouvrement des dettes bancaires.
Qu'est-ce que le délai de prescription bancaire ?
C'est le délai pendant lequel un établissement bancaire ou un organisme de crédit peut agir en justice pour obtenir le paiement d'une dette. Au-delà, l'action en justice devient impossible, ce qui signifie que le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à rembourser la somme due.
Cette règle s'applique principalement aux crédits à la consommation et aux opérations de découvert bancaire. Elle vise à protéger les consommateurs contre des réclamations trop anciennes et à encourager les créanciers à agir rapidement.
La forclusion bancaire : une notion clé
Définition de la forclusion en droit bancaire
On parle de forclusion lorsque le délai de prescription est expiré et que la banque ne peut plus agir pour obtenir le remboursement de sa créance.
Il s'agit d'une sanction procédurale qui éteint le droit d'agir en justice.
Différence entre prescription et forclusion
Bien que ces deux notions soient souvent confondues, elles présentent des différences importantes. La prescription, telle que définie par le Code de la consommation, éteint l'action en justice après l'expiration d'un délai de deux ans. La dette existe toujours juridiquement, mais le créancier ne peut plus contraindre le débiteur à payer.
La forclusion, quant à elle, est une sanction de procédure qui intervient lorsqu'une action n'a pas été exercée dans les délais légaux imposés. En matière bancaire, le délai de forclusion coïncide souvent avec le délai de prescription de deux ans pour les crédits à la consommation.
La distinction peut sembler subtile, mais elle a son importance sur le plan juridique.
Point de départ du délai de prescription de 2 ans
Comment est déterminé le point de départ ?
Le point de départ du délai de prescription est un élément crucial que j'examine systématiquement dans les dossiers que je traite. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le délai de prescription commence à courir à partir du premier incident de paiement non régularisé.
Concrètement, cela signifie que le délai débute le jour où vous avez manqué une échéance de remboursement et que celle-ci n'a pas été régularisée dans le mois suivant. Si vous avez repris les paiements, le point de départ se trouve au dernier incident de paiement non régularisé.
Cette règle s'applique de manière stricte et la date doit être établie avec précision.
Interruption et suspension du délai de prescription
Les actes qui interrompent le délai
L'interruption du délai de prescription efface le temps déjà écoulé et fait repartir un nouveau délai à zéro. En matière bancaire, plusieurs actes peuvent provoquer cette interruption.
- La mise en œuvre d'une action en justice par le créancier constitue le principal acte interruptif. Dès qu'une assignation est délivrée, le délai est interrompu et un nouveau délai commence à courir à compter de la fin de la procédure judiciaire.
- La reconnaissance de dette par le débiteur interrompt également la prescription. Cette reconnaissance peut prendre différentes formes : un courrier dans lequel vous reconnaissez devoir la somme, la signature d'un plan de remboursement, ou même un paiement partiel accompagné d'une mention explicite reconnaissant l'ensemble de la dette.
Les événements qui suspendent le délai
La suspension du délai de prescription diffère de l'interruption. Lorsque le délai est suspendu, il cesse de courir pendant une certaine période, puis reprend là où il s'était arrêté une fois l'événement suspensif terminé.
Les cas de suspension sont plus rares en matière bancaire. On peut citer notamment l'ouverture d'une procédure de surendettement devant la commission de surendettement, qui suspend les actions en recouvrement et donc le délai de prescription.
Les conséquences de l'interruption ou de la suspension
Les conséquences de l'interruption sont importantes : un nouveau délai de deux ans commence à courir intégralement. Si une banque vous assigne en justice à vingt-trois mois après le premier incident de paiement, l'interruption fait repartir un nouveau délai de deux ans à compter du moment où le juge rendra sa décision.
En cas de suspension, le délai reprend son cours normal une fois l'événement suspensif terminé. Par exemple, si une procédure de surendettement suspend le délai pendant un an, celui-ci reprendra ensuite pour la durée restante.
Ces mécanismes peuvent considérablement allonger la période pendant laquelle une banque peut agir.
Que se passe-t-il une fois le délai de 2 ans expiré ?
La dette devient irrécouvrable pour la banque
Une fois le délai de prescription de deux ans expiré, la dette devient juridiquement irrécouvrable pour la banque. Cela signifie que l'établissement bancaire ne peut plus engager d'action en justice pour obtenir le paiement de la somme due.
Les recours possibles pour le débiteur
Lorsque vous constatez qu'une dette bancaire est prescrite, vous disposez de plusieurs recours. Le premier consiste simplement à opposer la prescription au créancier ou à la société de recouvrement qui tenterait d'obtenir le paiement.
Si la banque persiste malgré la prescription acquise, vous pouvez saisir le juge pour faire constater la prescription et obtenir l'arrêt des poursuites. Dans certains cas, vous pourriez même demander des dommages et intérêts si les agissements de la banque ou de la société de recouvrement sont abusifs.
Les risques de ne pas agir face à une dette prescrite
Certaines sociétés de recouvrement continuent leurs relances en espérant obtenir un paiement ou une reconnaissance de dette qui interromprait la prescription.
Le principal risque est de reconnaître involontairement la dette, par exemple en effectuant un paiement partiel ou en signant un document sans en mesurer les conséquences juridiques. Cette reconnaissance ferait repartir un nouveau délai de prescription.
Par ailleurs, même si la dette est prescrite, elle peut continuer à figurer sur vos relevés bancaires ou dans les fichiers de la banque, ce qui peut avoir un impact sur votre relation bancaire future.
L'action des sociétés de recouvrement
Face à une société de recouvrement qui réclame le paiement d'une dette, la démarche à suivre est claire. Vous devez opposer formellement la prescription par LRAR.
Il est également utile de rappeler à la société de recouvrement ses obligations légales et de mentionner que la poursuite des démarches de recouvrement pourrait constituer un abus. Dans ma pratique, ce type de courrier met généralement fin aux relances.
Cas pratiques et jurisprudences
Exemple concret de prescription d'une créance bancaire
Permettez-moi de vous présenter un cas que j'ai traité récemment. Une personne avait souscrit un crédit à la consommation en 2018 pour financer l'achat d'une voiture. Suite à des difficultés financières, il a cessé de payer les échéances à partir de juin 2020. Aucun paiement n'a été effectué depuis cette date.
En 2023, soit trois ans après le dernier incident de paiement, une personne a été contacté par une société de recouvrement mandatée par l'organisme de crédit. Cette société lui réclamait la totalité du capital restant dû, majoré d'intérêts.
Après analyse du dossier, j'ai pu constater que le délai de prescription de deux ans était largement dépassé. Le point de départ se situait en juin 2020, et nous étions en 2023. J'ai donc opposé la prescription à la société de recouvrement, qui a mis fin à ses démarches.
Décisions de justice notables sur le délai de 2 ans
La jurisprudence de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur l'application du délai de prescription de deux ans. Un arrêt de la Cour de cassation en date de juin 2015 a ainsi confirmé que le délai commence à courir dès le premier incident de paiement non régularisé, et non à la date de la déchéance du terme.
Une autre décision notable de la Cour d'appel a précisé que la simple relance par une société de recouvrement ne constitue pas un acte interruptif de prescription. Seule une action en justice ou une reconnaissance expresse de dette par le débiteur peut interrompre le délai.
Conseils pour les particuliers face aux dettes bancaires anciennes
Vérifier attentivement la date de la créance
Mon premier conseil est de toujours vérifier attentivement la date de votre créance. Demandez à la banque ou à la société de recouvrement de vous communiquer l'historique complet des paiements et des incidents. Vous avez le droit d'obtenir ces informations.
Reconstituez ensuite la chronologie pour identifier le point de départ du délai de prescription. Comptez deux ans à partir du premier incident de paiement non régularisé. Si ce délai est dépassé et qu'aucun acte interruptif n'est intervenu, la créance est prescrite.
Ne pas reconnaître la dette sans avis juridique
C'est un point sur lequel j'insiste particulièrement auprès de mes clients : ne reconnaissez jamais une dette ancienne. Une reconnaissance de dette, même implicite, peut faire repartir le délai de prescription et vous priver du bénéfice de cette protection légale.
Ne signez aucun document, ne faites aucun paiement, même symbolique, et ne répondez pas aux sollicitations sans avoir vérifié au préalable si la créance n'est pas prescrite. Un moment d'inattention peut avoir des conséquences financières importantes.
Si vous recevez une proposition de règlement amiable ou un plan de remboursement, prenez le temps de consulter un avocat avant de donner votre consentement.
Conclusion
Si vous êtes confronté à une réclamation concernant une ancienne dette bancaire, prenez le temps de vérifier la prescription avant de prendre toute décision. Et n'oubliez pas : face à des enjeux juridiques importants, l'accompagnement d'un avocat spécialisé en droit bancaire peut faire toute la différence.
Guillaume PIERRE
Avocat en droit bancaire