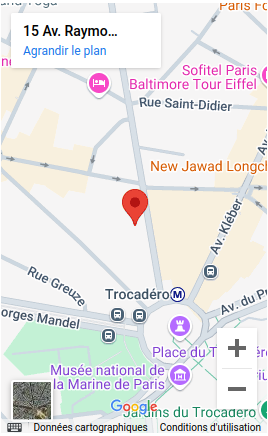La banque doit interroger le client sur des ordres de paiement inhabituels
En tant qu'avocat spécialisé en droit bancaire, je constate régulièrement que les questions relatives aux obligations de vigilance des établissements bancaires suscitent de nombreuses interrogations. Lors du traitement d'ordres de paiement inhabituels, il est crucial que la banque doive interroger le client. Un arrêt récent de la Cour d'appel de Pau, rendu le 6 juin 2024, vient préciser de manière significative l'étendue du devoir de vigilance qui pèse sur les banques face à des ordres de paiement inhabituels.
Le devoir de vigilance du banquier face aux ordres de paiement inhabituels
Quand une banque doit-elle interroger son client sur un ordre de paiement ?
L'affaire jugée par la Cour d'appel de Pau illustre parfaitement les situations où la vigilance particulière du banquier doit s'exercer.
Dans cette affaire, une société avait vendu un bien immobilier en 2020, le produit de la vente ayant été versé sur son compte. Entre octobre et décembre 2020, cette même société a effectué neuf virements pour un montant total de 1 601 600 € vers des comptes situés en Pologne, aux Pays-Bas et au Portugal.
Le dirigeant pensait réaliser des investissements à fort rendement, mais il s'agissait en réalité d'escroqueries, une forme d'escroquerie particulièrement répandue, également connue sous le nom de fraude au président dans certains cas.
L'identification des ordres de paiement inhabituels
La juridiction a identifié plusieurs critères permettant de caractériser le caractère inhabituel de ces opérations de paiement :
- Le volume et la fréquence : neuf virements réalisés dans un laps de temps très bref présentaient un caractère exceptionnellement inhabituel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société. Historiquement, le compte ne connaissait que des mouvements de trésorerie courante avec des virements n'excédant pas 12 000 €.
- La destination des fonds : le transfert rapide et massif de fonds vers des comptes ouverts à l'étranger, notamment en Pologne, au nom de tiers, conférait aux ordres de virement un caractère manifestement inhabituel.
- L'anomalie intellectuelle : la juridiction a souligné que ces opérations présentaient une anomalie intellectuelle, d'autant plus préoccupante qu'elles émanaient d'un dirigeant âgé de 78 ans.
Le rôle du banquier dans la prévention de la fraude
Face à de tels signaux d'alerte, la banque ne peut pas se contenter d'exécuter mécaniquement les ordres de paiement, même s'ils sont formellement réguliers. Elle doit interroger son client sur la cohérence et la sûreté de ses ordres de virement lorsque ceux-ci sont inhabituels et dissonants, susceptibles de l'exposer à un grave dommage en cas de fraude.
Cette obligation s'inscrit dans le cadre plus large du devoir de vigilance du banquier, qui impose aux établissements de crédit de détecter les opérations suspectes pouvant traduire une situation de fraude dont leur client serait victime.
Les limites du devoir de vigilance du banquier
L'absence d'anomalie apparente
Il convient de préciser que la banque n'est pas tenue à une obligation de surveillance absolue.
Son devoir s'active en présence d'éléments objectifs et vérifiables permettant de caractériser le caractère inhabituel ou suspect d'une opération. En l'absence de telles anomalies apparentes, l'établissement peut légitimement exécuter les ordres de son client.
L'absence d'anomalies apparentes constitue donc un critère déterminant pour apprécier la responsabilité du banquier. En l'absence d'anomalie apparente, aucune vérification supplémentaire n'est exigée.
La négligence grave du client
L'arrêt de la Cour d'appel de Pau rappelle également que le client conserve une part de responsabilité dans la survenance du dommage. En l'espèce, la société victime s'est vu imputer 50 % du préjudice subi, témoignant d'une responsabilité partagée entre la banque et son client, principe de droit fondamental à partager équitablement.
La responsabilité de la banque en cas de fraude
Le cas des opérations de paiement non autorisées
Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée, la responsabilité de la banque peut être engagée sur le fondement de l'inexécution de son obligation de restitution des fonds. La preuve de l'absence d'autorisation incombe généralement au client.
Le cas des opérations de paiement autorisées
La situation est plus complexe lorsque les opérations ont été formellement autorisées, mais que celui-ci en a été victime d'une fraude. C'est précisément le cas dans l'affaire jugée par la Cour d'appel de Pau. Dans ce contexte, la responsabilité de la banque peut être engagée sur le fondement de son manquement au devoir de vigilance.
Le préjudice réparable doit alors être regardé comme une perte de chance de détecter la fraude. Cette qualification juridique est importante car elle implique que le préjudice indemnisable ne correspond pas nécessairement à l'intégralité des sommes détournées, mais à la probabilité que la fraude aurait pu être évitée si la banque avait rempli son obligation de vigilance, un aspect essentiel du droit bancaire.
Les recours du client face à une opération frauduleuse
La procédure à suivre après une fraude
Face à une opération frauduleuse, je conseille systématiquement à mes clients de respecter une procédure rigoureuse :
- Signaler immédiatement l'opération suspecte à la banque, idéalement par écrit avec accusé de réception
- Constituer un dossier probatoire rassemblant tous les éléments démontrant le caractère inhabituel des opérations
- Déposer plainte auprès des autorités compétentes
- Mettre en demeure la banque de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées
L'indemnisation par la banque
Lorsque la responsabilité de la banque est établie, l'indemnisation peut prendre plusieurs formes. Toutefois, comme l'illustre l'arrêt commenté, le juge peut décider d'un partage de responsabilité entre la banque et son client, notamment lorsque ce dernier a fait preuve de négligence ou d'imprudence, une solution à partager avec prudence.
Ce que dit la loi et la jurisprudence récente (2024-2025)
Les décisions clés de la Cour de cassation
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement affiné les contours du devoir de vigilance du banquier.
Les juges du fond, à l'instar de la Cour d'appel de Pau, s'inscrivent dans cette dynamique en sanctionnant les banques qui n'interrogent pas leurs clients face à des opérations manifestement inhabituelles.
La Cour de cassation a notamment précisé les critères d'appréciation des anomalies dans plusieurs décisions récentes. Elle a publié plusieurs décisions importantes en la matière et a confirmé cette approche dans de nombreux arrêts. La Cour de cassation a rappelé l'importance de vérifier l'identité du bénéficiaire dans certaines circonstances, en présence d'anomalies.
L'évolution du cadre légal européen et français
Le cadre juridique applicable aux services de paiement a connu d'importantes évolutions ces dernières années, notamment sous l'impulsion du droit européen. La directive sur les services de paiement (DSP2) a renforcé les obligations pesant sur les établissements de crédit en matière de sécurité des transactions et de lutte contre la fraude, renforçant ainsi la sécurité des données bancaires.
Le droit français, à travers notamment le Code monétaire et financier, impose aux établissements bancaires diverses obligations de vigilance, particulièrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Ces obligations trouvent à s'appliquer également dans le cadre de la prévention des fraudes dont leurs clients pourraient être victimes. L'article du Code monétaire et financier relatif aux services de paiement précise les obligations des prestataires de services et impose notamment un contrôle de sécurité renforcé. L'article du Code définit les droits et obligations de chaque partie, en droit bancaire.
Conclusion : l'importance d'une vigilance partagée
L'obligation de la banque
L'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 6 juin 2024 constitue une décision importante qui rappelle que les banques ne peuvent se contenter d'exécuter mécaniquement les ordres de leurs clients.
Elles doivent exercer une vigilance active, particulièrement lorsque des opérations présentent un caractère inhabituel au regard de l'historique du compte et des pratiques habituelles.
Cette vigilance implique concrètement d'interroger le client sur la nature, la finalité et la cohérence des opérations suspectes avant de procéder à leur exécution.
Le manquement à cette obligation peut engager la responsabilité de l'établissement bancaire. Cette décision confirme la jurisprudence en matière de manquement au devoir de vigilance bancaire.
La décision souligne l'importance de la vérification de l'identité du bénéficiaire. La décision rappelle que les données bancaires doivent être protégées et que l'existence d'un virement frauduleux impose une réaction rapide.
En présence d'anomalies, la banque doit effectuer des contrôles supplémentaires, une obligation essentielle en droit bancaire.
La responsabilité du client
Pour autant, la vigilance ne doit pas être à sens unique.
Le client conserve une responsabilité dans la gestion de ses comptes et doit faire preuve de prudence dans ses opérations, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements promettant des rendements inhabituellement élevés ou de transactions avec des tiers inconnus situés à l'étranger, afin d'éviter toute escroquerie.
La jurisprudence reconnaît ainsi une responsabilité partagée, incitant chaque partie à faire preuve de diligence.
Cette approche équilibrée me paraît juste et conforme à la réalité des relations bancaires, où la confiance doit s'accompagner d'une vigilance mutuelle dans l'intérêt de tous, un principe à partager largement.
Maître Guillaume PIERRE
Avocat en droit bancaire