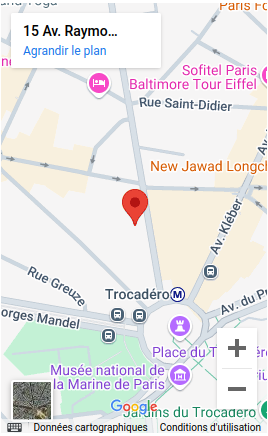Que devient un compte bancaire après le décès du titulaire ?
Lorsqu'un proche décède, la gestion de ses comptes bancaires soulève de nombreuses questions pour la famille et les héritiers. Que devient un compte bancaire après le décès du titulaire ?
Les comptes bancaires sont bloqués à la date du décès
Principe général : le blocage des comptes
Dès que la banque est informée du décès, elle procède immédiatement au blocage des comptes du défunt.
Ce blocage a une raison d'être : il vise à protéger l'actif successoral et à garantir que les fonds seront répartis conformément à la loi entre les héritiers.
Le solde du compte est alors "gelé" jusqu'au règlement de la succession.
Exceptions au blocage : paiements autorisés
L'établissement bancaire peut, dans des cas spécifiques, autoriser certains paiements malgré le décès du titulaire.
Paiement des frais d'obsèques
La première exception concerne le paiement des frais d'obsèques. En effet, l'article L312-1-4 du code monétaire et financier permet à la banque de débloquer une partie des fonds pour régler les factures liées aux funérailles.
Le montant débloqué est limité à 5 000 euros, à condition bien sûr que le solde du compte le permette.
Il suffit généralement de présenter les factures de l'entreprise de pompes funèbres pour obtenir le paiement.
Paiement des dernières factures courantes
La banque peut également continuer à honorer certains prélèvements pour les dépenses courantes du défunt : électricité, eau, gaz, loyer.
Toutefois, cette possibilité reste à l'appréciation de l'établissement bancaire et ne constitue pas un droit automatique.
Le sort des différents types de comptes
Le traitement du compte bancaire après un décès varie considérablement selon sa nature.
Compte bancaire individuel
Le compte individuel, ouvert au seul nom du défunt, est immédiatement bloqué dès que la banque est informée du décès. Aucune opération ne peut plus être effectuée, même par procuration.
Cette procuration prend fin automatiquement au jour du décès. Le mandataire ne peut donc plus utiliser le compte, même pour payer des dépenses urgentes.
Cette règle surprend souvent, mais elle s'explique : la procuration est un mandat qui s'éteint avec le décès du mandant et ne doit pas dégénérer en abus.
Compte joint
Un compte joint appartient indivisément à l'ensemble des cotitulaires.
Lorsque l'un des cotitulaires décède, le compte n'est pas systématiquement bloqué dans sa totalité.
Le cotitulaire survivant conserve généralement la possibilité de continuer à utiliser le compte pour les opérations courantes. Toutefois, la situation se complique car la part du défunt dans le solde du compte joint intègre la succession.
En effet, les héritiers du défunt ont des droits sur une partie du solde. Par principe, on considère que chaque cotitulaire possède une part égale du compte joint, sauf preuve contraire. Si le compte était détenu par deux personnes, la moitié du solde revient donc à la succession.
Le cotitulaire survivant peut continuer à effectuer des retraits, mais il doit être vigilant : prélever des sommes excessives pourrait être contesté par les héritiers.
Compte indivis
Le compte indivis, moins répandu que le compte joint, fonctionne différemment. Il nécessite l'accord de tous les cotitulaires pour effectuer une opération.
En cas de décès de l'un des titulaires d'un compte indivis, le blocage est généralement plus strict.
Les héritiers du défunt prennent sa place dans l'indivision, et toute opération nécessite alors l'accord de l'ensemble des coïndivisaires, anciens et nouveaux.
Que deviennent les produits d'épargne et les placements ?
Les produits d'épargne du défunt suivent un traitement spécifique. Le livret A, le PEL, le livret de développement durable ou encore les comptes à terme sont également bloqués à la date du décès.
Ces placements intègrent l'actif successoral et leur valeur à la date du décès sera prise en compte dans le règlement de la succession.
Le notaire en charge de la succession devra obtenir de la banque une attestation précisant le montant de ces différents produits d'épargne.
Concernant l'assurance vie, le principe diffère notablement : les sommes ne font généralement pas partie de la succession et sont versées directement aux bénéficiaires désignés dans le contrat.
Les valeurs mobilières (actions, obligations) détenues sur un compte titres sont également transmises aux héritiers, mais leur gestion pendant la période de succession nécessite souvent l'intervention du notaire.
Les démarches à effectuer auprès de la banque
Qui doit déclarer le décès à la banque ?
N'importe quel membre de la famille ou héritier peut informer la banque du décès. Dans les faits, cette démarche est souvent effectuée par le conjoint survivant, un enfant ou un proche du défunt.
Quand faut-il prévenir la banque ?
Le délai pour informer la banque n'est pas strictement encadré par la loi. Cependant, il est dans l'intérêt de tous de prévenir l'établissement dès que possible après le décès.
Documents nécessaires pour la banque
L'acte de décès est évidemment indispensable.
La banque exigera également, dans un second temps, un acte de notoriété.
Ce document, établi par le notaire, atteste de la qualité d'héritier et permet à la banque de savoir à qui elle doit transmettre les fonds.
Sans cet acte, impossible d'obtenir le déblocage des comptes et la clôture du compte bancaire.
Les frais bancaires liés à une succession
Les cas de gratuité des frais
Depuis plusieurs années, la réglementation a considérablement évolué sur ce point.
Aujourd'hui, un grand nombre d'opérations liées au décès doivent être réalisées gratuitement par l'établissement bancaire :
- La consultation du solde des comptes bancaires du défunt et du dernier relevé de compte bancaire,
- la délivrance des informations sur l'actif bancaire,
- la clôture du compte après règlement de la succession ne peuvent donner lieu à facturation.
- la transmission des informations au notaire.
J'insiste toujours auprès de mes clients sur ce point : si votre banque tente de vous facturer ces opérations, vous êtes en droit de refuser.
Risques en cas de non déclaration du décès
Ne pas déclarer le décès à la banque expose à plusieurs risques que je me dois de souligner.
L'accumulation de frais bancaires
D'abord, si des prélèvements automatiques continuent à fonctionner et mettent le compte à découvert, des frais bancaires peuvent s'accumuler. Or, ces frais viendront réduire l'actif successoral et devront in fine être supportés par les héritiers.
L'utilisation frauduleuse du compte après le décès
J'ai malheureusement été confronté à des situations où un proche, disposant de la carte bancaire du défunt, a continué à effectuer des retraits.
Cette pratique peut être qualifiée de vol ou d'abus de confiance et expose son auteur à des poursuites pénales, sans compter les conflits familiaux qui en découlent inévitablement.
N'hésitez pas à me consulter pour vous accompagner dans ces démarches.
Maître Guillaume PIERRE
Avocat en droit bancaire